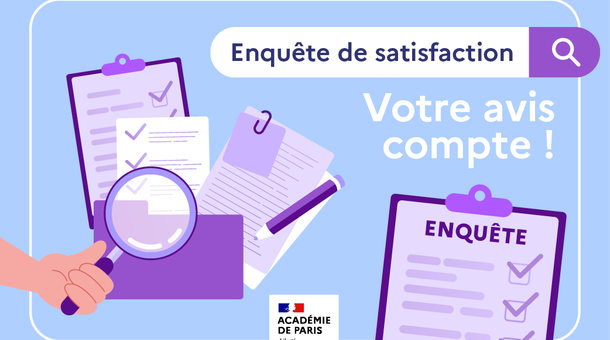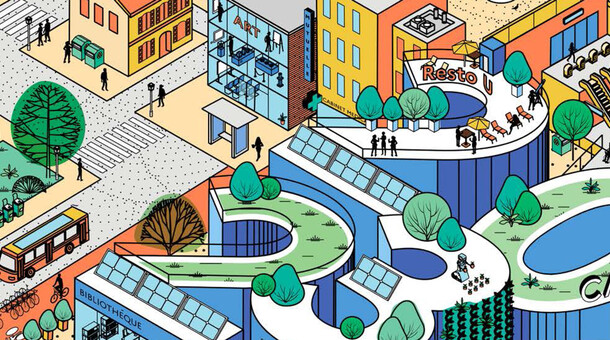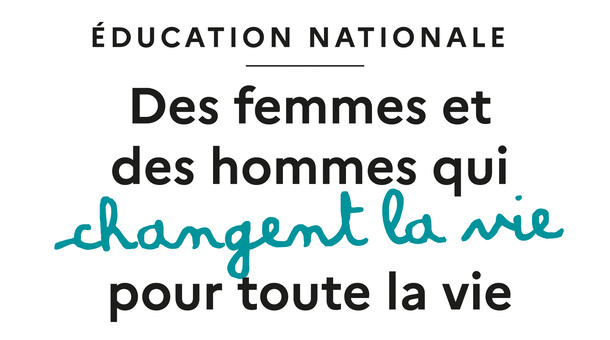Que recherchez-vous ?
Monsieur Bernard Beignier est nommé recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France en conseil des ministres le 3 avril 2024, par décret du Président de la République.

Un stage en juin pour les élèves de seconde générale et technologique
Mise à jour : mars 2024
Instauré pour l’ensemble des élèves de seconde générale et technologique dès juin 2024, le nouveau stage d’observation obligatoire en fin de seconde se déroulera du 17 au 28 juin 2024.

À la Une
Déposer en ligne un dossier de candidature en cursus spécifique
Mise à jour : février 2024
Lire le contenuSécurité des espaces numériques de travail (ENT) : mesures et conseils
Mise à jour : avril 2024
Lire le contenuMonmaster : l'adresse unique pour trouver son master et candidater
Mise à jour : mars 2024
Lire le contenuUn réseau des référentes et référents RH de proximité en établissement
Mise à jour : novembre 2023
Lire le contenuParents / élèves
Parents / élèves
Mise à jour : janvier 2024
- S'inscrire à l'école, au collège ou au lycée
- Élèves nouvellement arrivés en France
- Résultats d'affectation
- Bourses et aides financières du collège et lycée (6e à la Terminale)
- FAQ
- Prendre rendez-vous
- Élèves à besoins éducatifs particuliers

Conseil national de la refondation
« CNR EDUCATION – NOTRE ÉCOLE, FAISONS-LA ENSEMBLE »
Mise à jour : avril 2024
Dans le cadre du conseil national de la refondation, une démarche participative a été initiée dans l'académie de Paris pour permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de se réapproprier l'Ecole.

Contacter l'académie
Académie de Paris
12 boulevard d'Indochine 75019 Paris
Tél. : 01.44.62.40.40
Site : https://www.ac-paris.fr